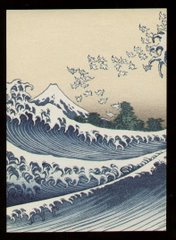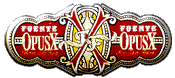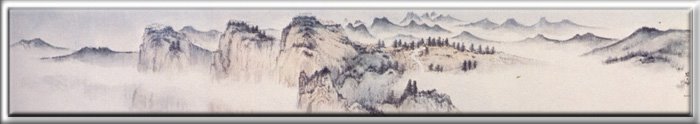Arunachala, la montagne sacrée.

jeudi 28 août 2008
jeudi 26 juin 2008
Impact du changement climatique sur les fonctions vitales des micro-organismes
 Le changement climatique n’aura pas seulement des conséquences sur les plantes et les animaux mais affectera aussi les micro-organismes, bactéries, champignons et autres populations microbiennes qui accomplissent une myriade de fonctions importantes pour la vie sur Terre. Les scientifiques ne sont pas entièrement certains de ce que seront ces effets, mais ils pourraient s’avérer significatifs et seront probablement néfastes, ont déclaré des chercheurs le 3 juin à Boston, lors d’une réunion de la Société Américaine de Microbiologie.
Le changement climatique n’aura pas seulement des conséquences sur les plantes et les animaux mais affectera aussi les micro-organismes, bactéries, champignons et autres populations microbiennes qui accomplissent une myriade de fonctions importantes pour la vie sur Terre. Les scientifiques ne sont pas entièrement certains de ce que seront ces effets, mais ils pourraient s’avérer significatifs et seront probablement néfastes, ont déclaré des chercheurs le 3 juin à Boston, lors d’une réunion de la Société Américaine de Microbiologie.
Les microbes accomplissent un nombre de fonctions cruciales au profit des écosystèmes à travers le monde. Or, la compréhension des effets du changement climatique sur eux n’en est qu’à ses débuts, a indiqué Kathleen Treseder, de l’Université de Californie, Irvine. Treseder a étudié l’effet de la hausse des températures et des champignons sur les réserves de carbone dans les forêts boréales de l’Alaska, une zone du globe qui connaît un réchauffement plus important que d’autres. Il y a une grande quantité de matériaux morts sous la couverture de neige. Il y a autant de carbone piégé dans le sol des écosystèmes du Nord qu’il y en a dans l’atmosphère. Une grande inconnue est ce qui se produira si ces environnements se réchauffent, ajoute Treseder.
Elle a commencé ses recherches en supposant qu’une augmentation des températures conduirait à une décomposition accrue par les champignons. Sachant qu’un sous-produit de la décomposition par les champignons est le dioxyde de carbone, l’augmentation des températures entraînerait la libération d’une plus grande quantité de dioxyde de carbone en provenance du sol. Treseder trouva en fait que l’augmentation des températures s’accompagnait de niveaux d’azote accrus dans le sol, et que l’azote tendait à abaisser les taux de décomposition fongique. L’azote amoindrissait ainsi l’activité et la diversité. Résultat final : la production d’une moindre quantité de dioxyde de carbone par les champignons à mesure de l’augmentation des températures dans les écosystèmes du Nord.
La hausse des températures a aussi des conséquences sur la couverture de neige et les glaciers. Cela peut être néfaste aux communautés de micro-organismes vivant en dessous de ceux-ci. Steven Schmidt, de l’Université du Colorado, et ses collègues ont étudié les diverses populations de micro-organismes qui y vivent. Avec le retrait des glaciers, les micro-organismes perdent leur habitat. Ils s’éteindront probablement avant que les chercheurs ne puissent les étudier et ne se fassent une meilleure idée de leurs contributions. Schmidt a aussi étudié l’activité microbienne sous la couverture de neige dans les forêts de conifères. L’augmentation des températures aurait là aussi, globalement, des conséquences négatives.
Alors que la hausse des températures pourrait réduire la production microbienne de dioxyde de carbone, les niveaux croissants de dioxyde de carbone dus à l’activité humaine pourraient causer des changements subtils mais importants dans la composition des populations microbiennes, déclare John Kelly, de l’Université Loyola, Chicago. Kelly étudie l’effet d’une quantité accrue de dioxyde de carbone sur les populations microbiennes présentes aussi bien sur les feuilles des arbres dans le Michigan du Nord que dans les feuilles se décomposant dans les rivières. Il a observé un changement dans certaines populations microbiennes. Ceci pourrait avoir un énorme impact sur la chaîne alimentaire dans la mesure où les microbes sont une source d’éléments nutritifs pour les petits animaux qui se nourrissent sur les feuilles.
Les micro-organismes se révèlent sensibles aux changements globaux. La seule chose sur laquelle une incertitude demeure est la manière dont ils réagiront, conclut Treseder.

Source : © Centre International de Recherche Scientifique
lundi 23 juin 2008
Malade
 Hé oui, depuis vendredi matin, cloué au lit entre 38,5 et 39°C de fièvre. Peut-être le corps en avait-il marre de ces horaires à la n'importe quoi...? Ou peut-être autre chose...? Ou peut-être rien.
Hé oui, depuis vendredi matin, cloué au lit entre 38,5 et 39°C de fièvre. Peut-être le corps en avait-il marre de ces horaires à la n'importe quoi...? Ou peut-être autre chose...? Ou peut-être rien.
J'ai battu mon record de sommeil : 24 heures sur 26 (et sans médicaments, s'il vous plait). Qui dit mieux ?
Plus sérieusement, c'était comment...?
lundi 2 juin 2008
Le magicien d'os

dimanche 1 juin 2008
dimanche 25 mai 2008
samedi 24 mai 2008
Blagounette du petit matin
 Trois moines Tibétains se sont retirés pour méditer dans une grotte.
Trois moines Tibétains se sont retirés pour méditer dans une grotte.
Au bout de deux ans, un cheval sauvage entre dans la grotte et en ressort aussitôt.
Deux ans plus tard, le premier dit:
- Quel beau cheval blanc !!!
Quatre ans plus tard le second dit :
- D'abord il était pas blanc, il était gris.
Six ans plus tard, le troisième dit:
- Puisque vous faîtes que de vous engueuler, je me casse.
mercredi 21 mai 2008
samedi 17 mai 2008
vendredi 16 mai 2008
jeudi 1 mai 2008
mercredi 30 avril 2008
Lila
 Moïse, Jésus et un petit vieux barbu jouent au golf.
Moïse, Jésus et un petit vieux barbu jouent au golf.
Moïse prend son bâton et d'un coup élégant, envoie sa balle. Elle monte en l'air avec un superbe mouvement parabolique et tombe en plein milieu du lac !
Moïse ne se perturbe pas. Il lève son bâton et à ce moment, les eaux s'ouvrent, lui laissant le passage pour faire un nouveau coup.
C'est maintenant au tour de Jésus. Il prend son bâton et, également d'une parabole parfaite (normal, c'est Jésus), il envoie sa balle dans le lac, où elle tombe sur une feuille de nénuphar. Sans s'énerver, Jésus se met à marcher sur l'eau jusqu'à la balle, et frappe à nouveau.
Ensuite, le petit vieux prend son bâton et, d'un geste affreux de celui qui n'a jamais joué au golf de sa vie, envoie sa balle sur un arbre. La balle rebondit sur un camion puis à nouveau sur un arbre. De là, elle tombe sur le toît d'une maison, roule dans la gouttière, descend le tuyau, tombe dans l'égout d'où elle se trouve lancée dans un canal qui l'envoie dans le lac mentionné ci-dessus.
Mais, en arrivant dans le lac, elle rebondit sur une pierre et tombe finalement sur la berge ou elle s'arrête. Un gros crapaud qui se trouve juste à côté l'avale. Soudain, dans le ciel, un épervier fonce sur le crapaud et l'attrape ainsi bien sûr que la balle. Il vole au-dessus du terrain de golf, et le crapaud, pris de vertige, finit par vomir la balle
juste dans le trou !
Moïse se tourne alors vers Jésus et lui dit :
- J'ai horreur de jouer avec ton père !
mercredi 16 avril 2008
lundi 31 mars 2008
Le neurone des baleines
Ces cellules cérébrales étaient présentées comme étant typiques des humains et des grands singes. Il est maintenant établi que les baleines possèdent également ces neurones en fuseau, des neurones spécialisés qui participeraient au traitement des émotions et nous aideraient ainsi à interagir socialement.
Les neurones en fuseau, nommés ainsi en raison de la forme de leur corps cellulaire, seraient impliqués dans le sentiment d'amour ainsi que d'autres émotions. Cette découverte chez les baleines relancerait le débat à la fois sur la question de leur intelligence mais également sur la question éthique de leur chasse par l'homme. En effet, les neurones en fuseau sont situés dans des zones du cerveau responsables de notre organisation sociale, de notre empathie (capacité à deviner ou ressentir l'émotion des autres), de la parole et d'autres réactions rapides et instinctives.
 Il semblerait que ces neurones existent dans des régions cérébrales homologues chez la baleine à bosse, les orques, le rorqual et le cachalot. De plus, les premières estimations suggèrent qu'ils en possèderaient trois fois plus que les humains, en prenant en compte la différence de taille.
Il semblerait que ces neurones existent dans des régions cérébrales homologues chez la baleine à bosse, les orques, le rorqual et le cachalot. De plus, les premières estimations suggèrent qu'ils en possèderaient trois fois plus que les humains, en prenant en compte la différence de taille.Selon Patrick Hof, de l'école de médecine du Mont Sinaï à New York (USA), co-découvreur des neurones en fuseau chez les baleines avec Estel van der Gucht du Consortium de Primatologie Evolutive à New York (USA): "Il est extrêmement clair pour moi que ce sont des animaux très intelligents. Nous devons être prudent concernant nos interprétations anthropomorphiques sur l'intelligence des baleines. Leur potentiel pour des fonctions cérébrales de haut niveau est clairement démontré au niveau comportemental et est maintenant confirmé par l'existence d'un type neuronal qui était pensait-on présent uniquement chez l'homme et ses plus proches parents". "Elles [les baleines] communiquent avec un répertoire énorme de sons, elles reconnaissent leurs propres sons et en font de nouveaux. Elles forment également des coalitions pour réaliser des stratégies de chasse, les apprennent aux individus les plus jeunes et ont un réseau social évolué similaire à celui des humains et des grands singes".
Comme chez l'homme, les neurones en fuseau ont été décelés dans le cortex cingulaire antérieur et le cortex fronto-insulaire, deux régions indispensables pour les réactions "viscérales" émotionnelles. De telles réactions sont basées sur des jugements émotionnels rapides, tel que savoir ou pas si un autre animal souffre ou la sensation générale si un évènement est plaisant ou déplaisant.
De plus, à la différence des humains, les chercheurs ont trouvé ces neurones chez les baleines dans le cortex fronto-polaire, à l'avant du cerveau, et également disséminés de manière éparse ailleurs. Hof déclare ne pas connaître la raison de la présence des neurones en fuseau dans les régions autres que celles établies chez l'homme et les grands singes.
Les neurones en fuseau n'ont par contre pas été découverts chez les dauphins. Hof précise qu'il serait intéressant de comparer l'intelligence des baleines à bosse avec celle des dauphins. Il est probable que le cerveau des dauphins utilise une stratégie complètement différente de celle des cellules en fuseau pour atteindre des résultats sans doute comparables.